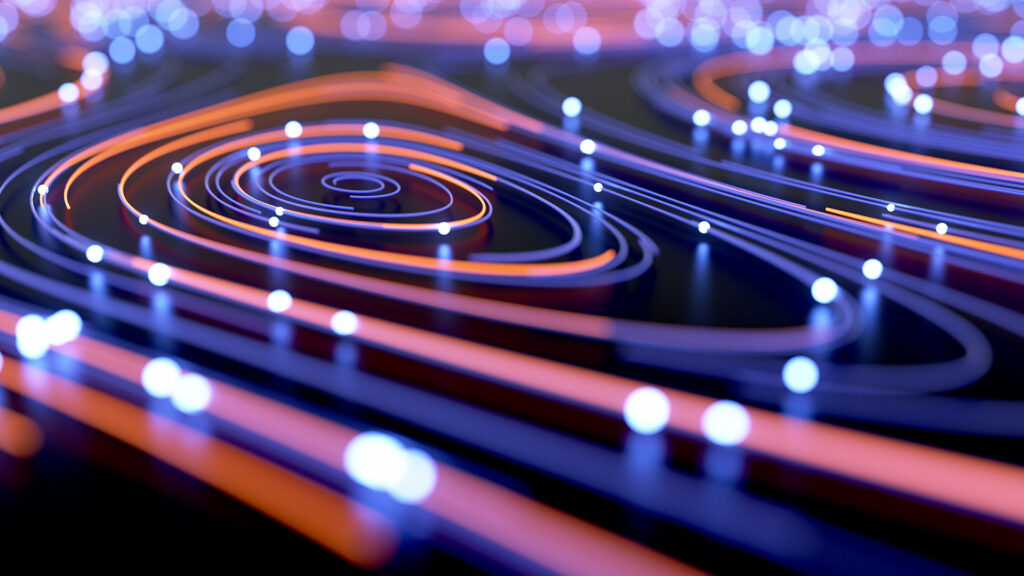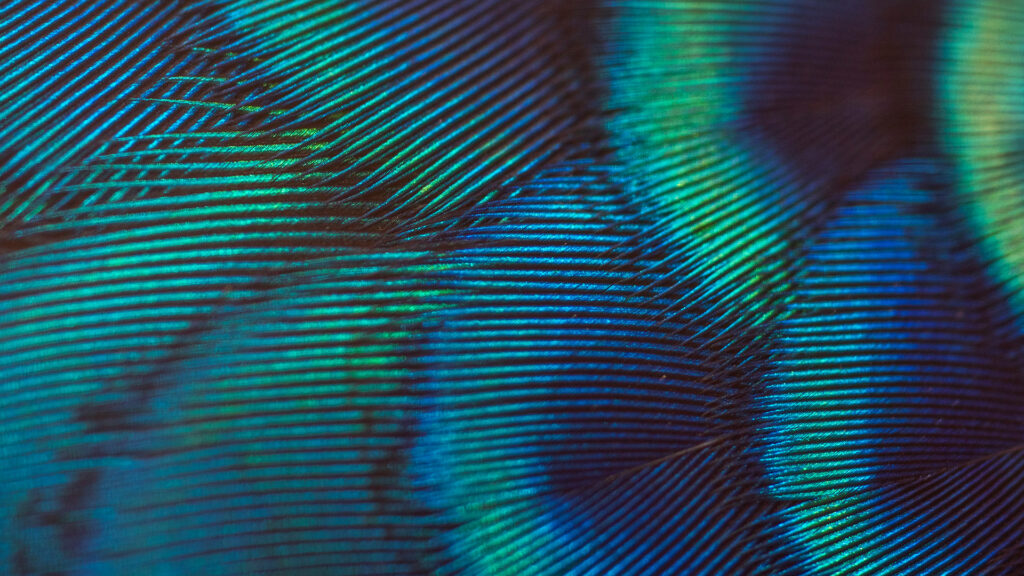Les Nouveautes en Matiere D’expertise Depuis le 1er Septembre 2025
L’été 2025 a été marqué par une profonde réforme de la procédure civile, impactant notamment le régime de l’expertise, tant conventionnelle que judiciaire. Les modifications apportées par les décrets n° 2025-619 et n° 2025-660 des 8 et 18 juillet 20251 visent notamment à renforcer la souplesse, l’efficacité et la sécurité juridique des opérations d’expertise, tout en favorisant le recours à l’expertise conventionnelle et aux modes amiables de règlement des différends.
Sauf exception2, les mesures introduites par les décrets des 8 et 18 juillet 2025, et clarifiées par voie de circulaires3, sont entrées en vigueur au 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours. Elles sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur la gestion de sinistres.
Modification des règles de compétence territoriale en matière de référé-expertise (article 145 du Code de procédure civile)
Le décret du 8 juillet 2025 (dit “Magicobus II”) modifie l’article 145 du Code de procédure civile pour préciser les règles de compétence territoriale applicables aux procédures fondées sur cette disposition (référé-expertise par exemple).
D’une part, il codifie la jurisprudence antérieure4 en prévoyant désormais que le demandeur peut saisir, à son choix, soit la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond, soit celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Cette codification rend la règle de compétence plus prévisible.
D’autre part, il prévoit une règle de compétence dérogatoire et exclusive en matière immobilière, en ajoutant à l’article 145 un alinéa 3 qui dispose que “lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”. Le demandeur ne pourra donc plus former sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur si celui-ci est distinct du lieu de situation de l’immeuble, et le juge saisi en violation de cette règle pourra relever d’office son incompétence (art. 77 CPC).
L’objectif affiché de cette réforme est de rééquilibrer la répartition du contentieux en matière immobilière, en évitant notamment sa concentration devant le Tribunal judiciaire de Paris qui était saisi de nombreuses demandes portant sur des immeubles situés en dehors de son ressort. Cette modification vient ainsi consacrer la jurisprudence “dissidente” du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 21 juin 2024 et qui avait été infirmée par la Cour d’appel de Paris le 24 octobre 20245.
Retour sur l’expertise “conventionnelle” mise en place dans le cadre d’une convention de procédure participative
Les articles 1547 à 1554 du Code de procédure civile, dans leur version antérieure au 1er septembre 2025, prévoyaient la possibilité pour les parties à un litige décidant d’avoir recours à une procédure participative6 de désigner conventionnellement un expert, le rapport de celui-ci ayant la même valeur qu’un rapport d’expert judiciaire.
Cette option était restée relativement peu utilisée en pratique, notamment en raison de l’absence de toute possibilité de solliciter l’appui du juge en cas de difficulté.
Le décret du 18 juillet 2025, dans la lignée du changement de paradigme érigeant en principe la mise en état conventionnelle des affaires civiles (la mise en état par le juge devenant l’exception – art. 127 CPC), réforme le régime de l’expertise conventionnelle afin de renforcer son attractivité7.
- Simplification des hypothèses de recours à l’expertise conventionnelle
L’article 131 du Code de procédure civile autorise désormais les parties à désigner conventionnellement un expert soit avant tout procès (en lieu et place de la saisine du juge sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile), soit une fois la procédure au fond engagée.
- Modalités de désignation du technicien
Comme antérieurement, les parties désignent le technicien d’un commun accord, fixent sa mission ensemble et conviennent des modalités de prise en charge, entre elles, de sa rémunération (art. 131 CPC).
La liberté contractuelle est donc de mise sur la répartition des honoraires de l’expert conventionnel, et différents systèmes sont envisageables (rémunération paritaire ou proratisée, rémunération provisoirement paritaire jusqu’au prononcé de la décision du juge du fond, par exemple supportée par la partie perdante proportionnellement aux demandes accueillies, rémunération paritaire entre les parties sans possibilité de recouvrer les frais exposés devant les juges du fond, etc.).
Comme antérieurement également, le technicien doit révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité (art. 131-1 CPC), agir avec conscience, diligence et impartialité, et dans le respect du principe de contradiction.
Il est désormais explicitement rappelé, comme en matière d’expertise judiciaire, qu’il ne peut pas porter d’appréciation juridique (art. 131-2 CPC).
- Appui du juge en cas de difficultés
L’une des nouveautés majeures du décret du 18 juillet 2025 est la possibilité de solliciter l’appui du juge en cas de difficultés survenant au cours de l’expertise conventionnelle (art. 131-3 CPC), qu’il s’agisse :
- de difficultés sur sa désignation ou son maintien ;
- de difficultés sur la rémunération du technicien ;
- de difficultés dans l’exécution de sa mission ;
- du refus d’une partie de communiquer les documents que le technicien estime nécessaires à sa mission (article 131-5 CPC) ;
- ou d’une divergence des parties sur la nécessité de révoquer le technicien (cette révocation ne pouvant à défaut intervenir que par accord unanime des parties).
Le décret crée ainsi l’équivalent du juge chargé du contrôle des expertises pour les expertises judiciaires, qui faisait défaut dans le régime antérieur.
Le juge compétent pour trancher ces difficultés sera le juge saisi de l’affaire ou, à défaut, le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond (art. 131-3 CPC).
L’objectif est donc que les demandes relatives aux difficultés d’exécution des expertises conventionnelles soient traitées rapidement, mais, tout comme en matière d’expertise judiciaire, la situation pourrait être variable en fonction des juridictions et de leur taux d’encombrement.
- Modalités de mise en cause de nouvelles parties à l’expertise conventionnelle
En matière d’expertise ordonnée par le juge, il est possible de rendre communes et opposables les opérations à une partie en l’assignant à cette fin devant la juridiction ayant ordonné l’expertise. Réciproquement, des parties peuvent également saisir le juge aux fins d’intervenir volontairement à l’expertise. Ces interventions (volontaire ou forcée) en cours d’expertise interviennent ainsi très fréquemment.
Dans le cadre de l’expertise conventionnelle, seule une intervention volontaire est réellement envisageable. En effet, même en supposant que l’expertise conventionnelle ait été décidée en cours de procédure au fond, et que l’une des parties appelle en intervention forcée un tiers dans cette procédure au fond, ce tiers ne pourra pas être contraint à participer à l’expertise conventionnelle puisque celle-ci repose sur un mécanisme s’apparentant à un contrat : il devra nécessairement manifester son accord pour “adhérer” à ce qui a été mis en place avant son intervention, ce qui s’apparente à l’hypothèse d’une intervention volontaire à l’expertise. L’hypothèse dans laquelle cette partie refuserait de participer à l’expertise conventionnelle poserait des difficultés, et notamment des questions d’opposabilité du rapport d’expertise.
Le Code de procédure civile prévoit en tout cas la possibilité pour un “tiers intéressé, avec l’accord des parties et du technicien, [d’] être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours”8. Il n’est cependant aucunement précisé si, en cas d’expertise conventionnelle décidée dans le cadre d’une procédure au fond, le tiers peut participer à l’expertise conventionnelle sans intervenir (ou être mis en cause) dans la procédure au fond. Par ailleurs, le refus des parties ou du technicien de voir le tiers intervenir à l’expertise pourrait le contraindre à devoir solliciter, en parallèle, une mesure d’expertise judiciaire, qui sera potentiellement redondante.
Le système semble donc davantage propice à traiter des contentieux dans lesquels les situations sont “cristallisées” tels que les litiges bipartites ou tripartites. Il est en revanche plus difficile à mettre en œuvre dans des litiges impliquant un nombre important de parties et/ou dans les cas où des parties sont susceptibles de devoir être mises en cause en cours d’expertise. La désignation d’un expert judiciaire en référé pourrait rester, pour ces cas, une voie plus adaptée.
- Maintien de la force probante du rapport d’expertise conventionnelle
Le décret du 18 juillet 2025 préserve la règle posée antérieurement, selon laquelle le rapport d’expertise conventionnelle a la même force probante qu’un rapport d’expertise judiciaire si la convention désignant le technicien a été conclue entre avocats (art. 131-8 CPC)9.
Possibilité pour l’expert judiciaire de concilier les parties
Le décret du 18 juillet 2025 a abrogé l’article 240 du Code de procédure civile qui interdisait au technicien de concilier les parties. Désormais, tout comme devant les juridictions administratives, l’expert judiciaire pourra tenter d’amener les parties à parvenir à un règlement amiable du différend. Cette même faculté est également offerte aux experts désignés conventionnellement par les parties dans le cadre de conventions participatives10.
Il sera intéressant d’observer, dans les mois à venir, si les juridictions (ou les parties) s’empareront de cette faculté en adaptant les libellés de mission.
La circulaire d’application du décret vise à ce titre les hypothèses dans lesquelles l’expert judiciaire serait désigné comme médiateur par les parties ou par le juge. Elle évoque également la possibilité pour l’expert qui ne serait pas désigné comme médiateur de concilier les parties “selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile”.
Il demeure que les parties pourraient, dans certains cas, préférer continuer de distinguer la phase d’expertise (volet purement technique) de la phase de discussion amiable sous l’égide éventuelle d’un médiateur ou d’un conciliateur différent de l’expert judiciaire, afin de bénéficier le cas échéant d’un regard neuf sur le dossier qui, parfois, est propice à trouver un accord.
Possibilité pour le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction d’homologuer l’accord des parties à l’issue de l’expertise judiciaire
Le décret du 18 juillet 2025 a également modifié l’article 171-1 du Code de procédure civile qui dispose désormais que le juge chargé du contrôle des expertises pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
Cette compétence s’applique à un accord qui serait conclu en cours d’expertise judiciaire. En revanche, après le dépôt du rapport d’expertise et la taxation des honoraires de l’expert judiciaire, le juge du contrôle des expertises est dessaisi, de sorte que l’homologation de l’accord devrait alors être demandée au juge compétent pour connaitre du contentieux au fond (art. 1545 CPC).
Il est d’ailleurs intéressant de relever que la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a conféré une compétence identique au juge de la mise en état devant le Tribunal judiciaire (art. 785-1 CPC), au conseiller de la mise en état devant la Cour d’appel (art. 913 CPC) ou encore au juge chargé de l’instruction de l’affaire devant les tribunaux de commerce / tribunaux des activités économiques (art. 863 CPC), afin de faciliter l’homologation des accords intervenus amiablement.
Maya Chakarji, juriste, a contribué à la préparation de ce briefing.
Note de bas de page
- Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.
- Par exception, le titre VI du livre I du Code de procédure civile portant sur les conventions relatives à la mise en état n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
- [Circulaire de présentation du décret n° 2025-619 n° CIV/07/2025 et Circulaire de présentation du décret n° 2025-660 n° CIV/08/2025.
- Civ. 2e, 17 juin 1998, n° 95-10.563 ; Civ. 2e, 30 avril 2009, n° 08-15.421 ; Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-14.849 ; Com., 13 septembre 2017, n° 16-12.196 ; Civ. 2e, 15 octobre 2015, n° 14-17.564 et 14-25.654.
- TJ Paris, 21 juin 2024, n° 23/57361 ; CA Paris, 24 octobre 2024, 24/12032.
- C’est-à-dire décidant soit de tenter de résoudre amiablement leur litige, mais de façon structurée (convention de procédure participative), soit de mettre leur dossier en état d’être jugé en gérant elles-mêmes la phase de mise en état (convention de procédure participative aux fins de mise en état).
- Cette expertise amiable peut également être choisie au cours d’une instruction judiciaire ou en dehors de toute saisine de juridiction (nouvel article 131 du Code de procédure civile).
- Art. 131-6 CPC.
- La règle posée antérieurement semblait ne pas poser cette condition, mais en réalité, la désignation du technicien n’était possible que par un acte contre-signé par avocats, ce qui revient à la même chose que la condition désormais prévue par l’article 131-8 CPC.
- Circulaire de présentation du décret n° 2025-660 n° CIV/08/2025.