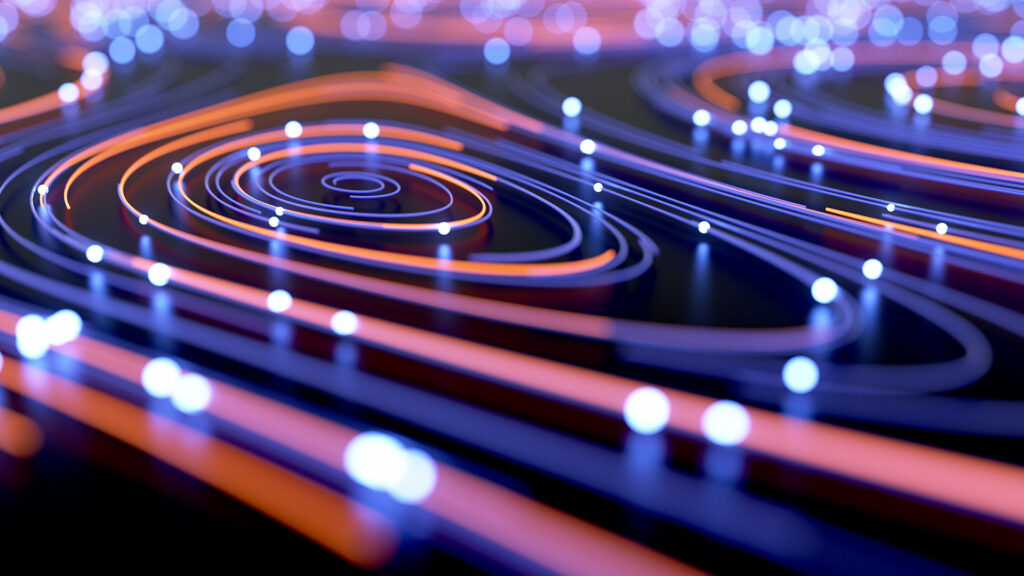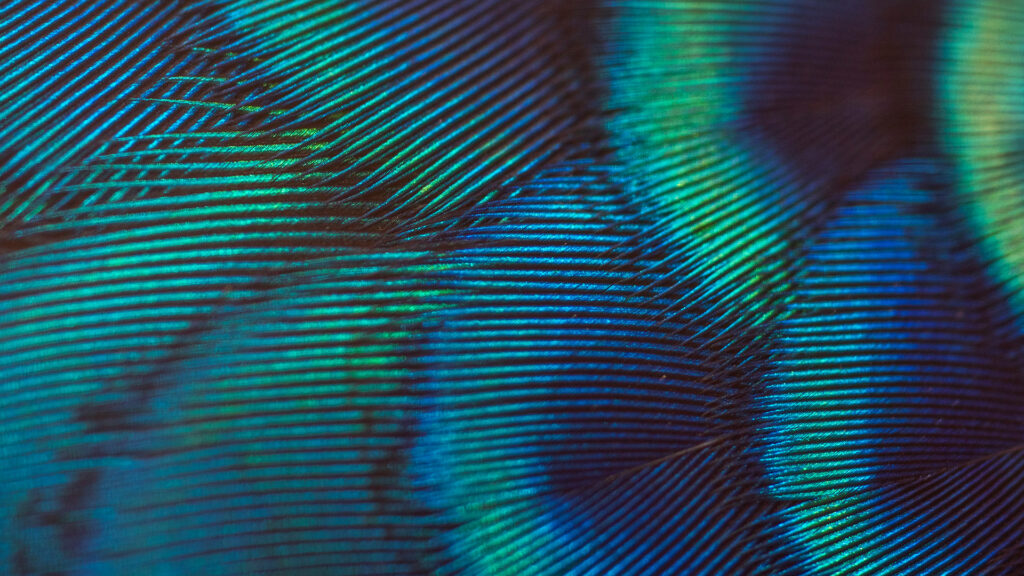Favoriser L’approche Amiable Dans Le Contentieux Civil Et Commercial : La Reforme Du 1er Septembre 2025
Appliquant les recommandations issues du rapport des Etats Généraux de la Justice de 2022, le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 réforme le déroulement de l’instance devant les juridictions civiles et commerciales, et renforce le recours aux modes amiables de règlement des différends (MARD).
Cette évolution vise à fluidifier le traitement des dossiers et à favoriser des solutions plus adaptées aux besoins des justiciables.
La réforme place le juge au cœur du recours aux modes amiables, en lui conférant notamment la possibilité de concilier les parties. Elle invite également les parties à s’investir personnellement dans ces modes de règlement des litiges, sous peine de sanction, et dans la conduite de leurs procédures au fond.
Les dispositions issues du décret sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025. Celles réformant la section du Code de procédure civile (CPC) consacrée aux conventions relatives à la mise en état sont applicables aux nouvelles instances. Les autres dispositions sont quant à elles applicables immédiatement, y compris aux instances en cours au 1er septembre 2025.
Obligation de rencontrer un médiateur ou un conciliateur sous peine d’amende civile
La réforme instaure une faculté pour le juge de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur, codifiant ainsi une pratique ayant cours devant certaines juridictions, le non-respect de l’injonction étant sanctionné par une amende civile.
Cette rencontre visera à informer les parties sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, sans qu’elles n’aient l’obligation d’accepter de mettre en œuvre un processus amiable – ni, à plus forte raison, de trouver un accord.
Les parties devront y participer en personne, éventuellement assistées de leur avocat (Art. 1533 CPC). Ainsi, les assureurs, lorsqu’ils sont parties à l’instance, devront être présents (et non simplement représentés par leur conseil) ce qui impliquera une organisation adéquate au sein des services de gestion de sinistres. Cette réunion pourra cependant être organisée en distanciel, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (Art. 1533-2 CPC).
Dans le but de renforcer l’efficacité de cette injonction, le médiateur ou le conciliateur pourra informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion (Art. 1533-1 CPC). La partie qui, sans motif légitime, ne se présenterait pas à cette réunion d’information s’expose à devoir payer une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros (Art. 1533-3 CPC).
Le décret ne définit pas le motif légitime, qui devra être apprécié au cas par cas. La circulaire d’application donne pour seul exemple “l’impossibilité matérielle de se déplacer”. Cela pourrait indiquer que les juridictions sont invitées à retenir une conception objective et étroite de cette notion.
Le texte laisse le juge libre de déterminer à quel moment de la procédure il souhaite faire usage de son pouvoir d’injonction (lorsqu’il souhaite effectivement en faire usage). L’efficacité de la rencontre avec le médiateur ou le conciliateur sera certainement renforcée si l’injonction du juge n’intervient pas trop tôt dans la procédure, mais plutôt après que les parties auront déjà pu échanger leurs arguments et pièces majeurs.
Portée de la confidentialité en matière d’audience de règlement amiable, de conciliation et de médiation
Le nouvel article 1528-3 al.1 du Code de procédure civile consacre un principe de confidentialité et dispose que “sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel”.
Il faut noter tout d’abord que ce principe de confidentialité ne s’applique pas à la conciliation menée par le juge lui-même, en dehors du cas de l’audience de règlement amiable.
Par ailleurs, le principe de confidentialité rappelé ci-dessus connaît de nombreuses limites. L’article 1528-3 du Code de procédure civile énonce en effet que :
- les parties peuvent y déroger d’un commun accord ;
- “les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité” (Art. 1528-3 al. 3 CPC). Elles pourront donc être versées aux débats en phase contentieuse en cas d’échec des discussions, alors que jusqu’à présent il était d’usage de considérer que les pièces échangées dans le cadre amiable étaient confidentielles.
En définitive, seuls les documents “élaborés” par les parties dans le cadre du processus amiable sont confidentiels.
Néanmoins, le texte ne définit pas ce qu’est un document “élaboré” dans le cadre du processus amiable. La circulaire d’application du décret évoque les “constatations [et] déclarations recueillies au cours de la médiation” ainsi que les pièces “qui ont été confectionnées au cours du processus amiable” (projet d’accord, déclarations recueillies par écrit).
La limitation de la confidentialité pourrait en tout cas conduire certaines parties à préférer s’abstenir de produire des éléments en leur possession par crainte que leur adversaire puisse, en cas d’échec de la phase amiable, les communiquer dans le cadre de la procédure. - enfin, il est fait exception à la confidentialité “en présence de raisons impérieuses d’ordre public”, “de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne”, ou encore “lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution” (Art. 1528-3 al. 4 CPC).
Il est important de noter que les principes ci-dessus s’appliquent aussi à la médiation et à la conciliation conventionnelles, décidées par les parties elles-mêmes en dehors de toute procédure judiciaire. Il peut donc être opportun, en pratique, de continuer à prévoir des clauses ou accords de confidentialité afin de fixer exactement l’étendue des obligations des parties en la matière et se prémunir de toute éventuelle difficulté.
Extension du champ d’application à toutes les juridictions (hors Conseil de Prud’hommes) du dispositif d’audience de règlement amiable
La réforme a également étendu le champ d’application de l’audience de règlement amiable (ARA).
Pour mémoire, ce dispositif, introduit par le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, a pour objet de confier à un juge, distinct de celui qui est saisi du litige, le rôle d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable.
Alors qu’il était initialement circonscrit aux procédures au fond et en référé devant le Tribunal judiciaire et devant le juge des contentieux de la protection, il est désormais prévu pour toutes les juridictions, sauf le conseil de prud’hommes (Art. 1532 al. 4 CPC), y compris en appel et devant la Cour de cassation.
Concernant le déroulement de l’ARA, l’article 1532-2 du Code de procédure civile exige désormais que les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées de leur avocat. La présence personnelle des parties sera donc en principe requise.
Les compagnies d’assurance et directions juridiques devront donc anticiper la signature de délégations de pouvoir afin d’être en capacité d’être valablement représentées à ces audiences.
Mesures visant à améliorer l’efficacité du processus de conciliation ou de médiation
Les dispositions applicables à la conciliation et la médiation sont désormais regroupées au sein d’un même titre. Elles bénéficient également d’une définition commune, selon laquelle elles “s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose” (Art. 1530 CPC). Ces processus se différencient essentiellement par le caractère bénévole de la conciliation et par la méthodologie mise en œuvre par le tiers assistant les parties.
Conciliation et médiation judiciaires : allongement de la durée initiale
La durée initiale de la médiation ou de la conciliation peut aller jusqu’à cinq mois (contre trois mois auparavant1) et peut être prolongée de 3 mois à la demande du conciliateur ou du médiateur (Art. 1534-4 CPC).
Conciliation et médiation conventionnelles : moyens de gestion des dossiers complexes
Lorsque les parties ont recours à la conciliation ou la médiation conventionnelles, en dehors ou au cours d’une instance (Art. 1536 CPC), le conciliateur ou le médiateur peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur ou médiateur, consacrant ainsi le principe de co-médiation (Art. 1536-1 CPC), rencontré notamment dans les dossiers les plus complexes.
Par ailleurs, le conciliateur ou le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile (Art. 1536-2 CPC).
De la même manière, l’article 1537 du Code de procédure civile accorde aux parties la possibilité de demander pendant le processus amiable conventionnel qu’il soit judiciairement ordonné une mesure d’instruction, une mesure conservatoire ou une mesure provisoire.
La mise en état des litiges devient par principe conventionnelle
Si les parties avaient la faculté de mettre en état leur affaire conventionnellement par l’intermédiaire d’une convention de procédure participative, cette phase restait, en pratique, essentiellement conduite par le juge.
Le décret du 18 juillet 2025 opère un changement radical en faisant de la mise en état conventionnelle des affaires civiles le principe, et de la mise en état par le juge, l’exception (Art. 127 CPC) : “les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement”.
Les parties peuvent dès lors soit conclure une convention de procédure participative, soit s’en remettre à la procédure d’instruction conventionnelle simplifiée prévue aux articles 129-1 et suivants Code de procédure civile.
Dans les deux cas, l’objectif est de mettre le litige en état d’être jugé. Les parties peuvent :
- déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ;
- fixer le calendrier de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, auquel elles devront se tenir, au risque sinon de voir écarter par le juge les éléments communiqués tardivement sans motif légitime, si cela porte atteinte aux droits de la défense ;
- recourir à un technicien ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
- consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs avocats ;
- consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage (ces déclarations étant alors recueillies ensemble par les avocats).
Les parties devront ainsi, en début de procédure, se mettre d’accord sur la manière dont leur dossier sera préparé en vue de son jugement par le Tribunal.
Elles disposent d’une liberté relativement importante, et l’on peut anticiper que, à côté de conventions de mise en état un peu standardisées qui seront développées progressivement par la pratique, certains dossiers justifieront une rédaction plus spécifique qui pourrait donner lieu à des négociations potentiellement délicates – voire une impossibilité pour les parties de s’entendre, avec pour conséquence que la mise en état du dossier sera effectuée par le juge comme antérieurement à la réforme.
L’avenir dira également si les auditions et témoignages, qui sont aujourd’hui peu utilisés dans les affaires commerciales ou civiles professionnelles, se développeront en tant que mode de preuve.
En l’état, l’intérêt essentiel de l’instruction conventionnelle sera de permettre aux parties de voir leur affaire audiencée prioritairement (Art. 127 al. 2 CPC). Si cet objectif est louable, les parties n’auront pas toujours toutes intérêt à voir l’affaire jugée à brève échéance.
Si les parties ne parviennent pas à mettre l’affaire en état conventionnellement, elles peuvent toujours solliciter du juge de procéder à son instruction judiciaire.
Conclusions et recommandations
La réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2025 vise très clairement à favoriser l’issue amiable des litiges, et à imposer aux parties à un contentieux de s’impliquer activement dans la gestion procédurale de celui-ci avant qu’il ne soit soumis au Tribunal pour être jugé.
Si le développement des MARD est à l’œuvre depuis plusieurs années, les nouvelles dispositions du Code de procédure civile conduiront nécessairement à une évolution des pratiques des entreprises et de leurs conseils en matière de gestion des contentieux. Les outils à la disposition des parties en matière de mise en état conventionnelle de leurs dossiers peuvent, à cet égard, contribuer à des approches innovantes si les parties s’en saisissent.
Note de bas de page
- Ancien articles 129-2 et 131-3 du CPC.