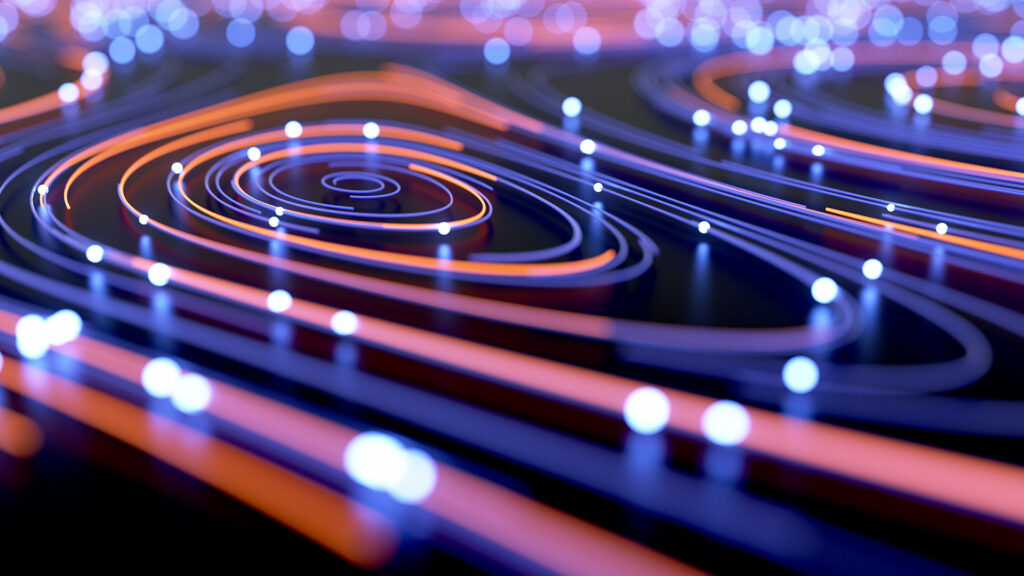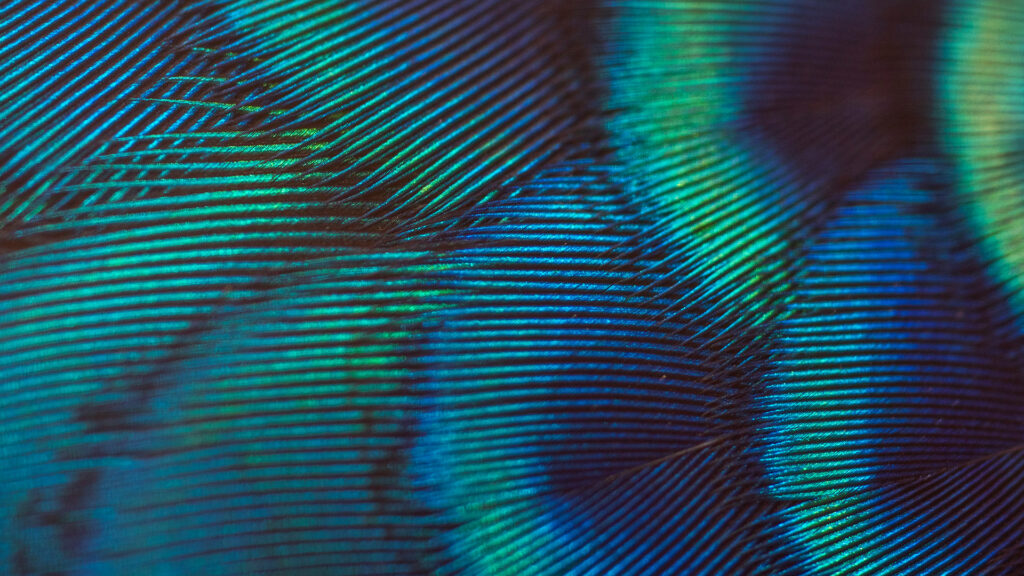Contribution Pour La Justice Economique: Un Nouveau Casse-Tête Pour Les Assureurs?
Depuis le 1er janvier 2025, les Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Versailles, Marseille, Lyon, Le Havre, Limoges, Avignon, Auxerre, Saint-Brieuc, Nancy et Le Mans sont devenus, “à titre expérimental” pour une durée de quatre ans1, des Tribunaux des activités économiques (“TAE”), en exécution de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du Ministère de la justice 2023-2027.
Les TAE ont vocation à connaître du contentieux relevant traditionnellement des Tribunaux de commerce ainsi que de celui des entreprises et professionnels en difficulté quels que soient leur statut et leur activité, à l’exception des professions du droit visées à l’article L. 722-6-1 du Code de Commerce.
Sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes, les justiciables agissant devant les TAE doivent s’acquitter au plus tard à la première audience d’une “contribution pour la justice économique”(“CJE“), venant accroître le coût des procédures.
Plus de six mois après l’entrée en vigueur de la loi n°2023-1059, et malgré les clarifications opérées par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 et la circulaire du Garde des Sceaux n° JUST2503734C du 6 février 2025, la CJE reste source d’interrogations.
Les incertitudes sur les critères d’application de la CJE
La CJE n’est due que par les demandeurs employant plus de 250 salariés et ayant réalisé en moyenne un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros et un bénéfice net supérieur à 3 millions d’euros, ou un chiffre d’affaires d’au moins 1,5 milliards d’euros sur les trois derniers exercices. Par ces seuils, le législateur a entendu n’assujettir à la CJE que des entreprises d’une certaine taille et profitabilité.
Elle ne s’applique qu’aux demandes supérieures à 50.000 euros et est plafonnée à 50.000 ou 100.000 euros selon le chiffre d’affaires réalisé par le demandeur.
Le seuil de 250 salariés
D’apparence simple, l’appréciation du critère d’un effectif d’au moins 250 employés pourrait toutefois s’avérer plus complexe, notamment lorsque la société demanderesse ne remplit pas ce seuil, mais que les salariés d’une autre société de son groupe travaillent pour elle.
Dans un tel cas de figure, l’effectif de la société demanderesse se situe, prima facie, en deçà du seuil de 250 salariés et pourrait légitimement considérer ne pas être assujetti à la CJE.
Les greffes, et en cas de contestation, le Président du Tribunal, pourraient toutefois avoir recours aux notions du droit du travail, telles que l’Unité Economique et Sociale (UES) permettant de qualifier des sociétés distinctes comme une seule “entreprise” pour calculer leurs effectifs et déterminer leurs obligations de mise en place d’instance représentatives du personnel.
La circulaire du 6 février 2025 renvoie d’ailleurs aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail pour le calcul des seuils d’effectifs d’une “entreprise”. Ces articles permettent par exemple de prendre en compte, sous certaines conditions, les salariés “mis à disposition” dans les seuils d’effectifs.
Une analyse au cas par cas devra donc être faite en fonction de la structure du groupe lorsque la société demanderesse n’atteint pas le seuil de 250 salariés, mais qu’elle bénéficie du travail de salariés d’une autre société du groupe. Dans certains cas, la demanderesse pourrait alors être assujettie à la CJE en cas de dépassement du seuil au sein du groupe ou de l’UES.
Les seuils d’application financiers et le barème des taux de la CJE
La CJE n’est due par la société demanderesse que lorsque le montant total de ses prétentions est supérieur à 50.000 €2, à l’exclusion des frais non compris dans les dépens (art. 700 CPC).
Le barème de la contribution dépend du chiffre d’affaires annuel moyen et du montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années, tels qu’ils ressortent des comptes de résultats des trois derniers exercices déclarés à l’administration fiscale.
Le montant de la contribution est alors établi de la manière suivante :
- pour les personnes morales ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices compris entre 50 M € et 1.5 Md €, et un bénéfice annuel moyen supérieur à 3 M € sur cette même période : le montant de la contribution est égal à 3% du montant des prétentions de l’acte introductif d’instance, dans la limite de 50.000 € (ce qui signifie que, dès lors que le montant total des prétentions est supérieur ou égal à 1.666.666,67 €, la contribution sera d’un montant fixe de 50 000 €) ;
- pour les personnes morales ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices de plus de 1.5 Md €, le montant de la contribution est égal à 5% du montant des prétentions de l’acte introductif d’instance dans la limite de 100.000 € (ce qui signifie que, dès lors que le montant total des prétentions est supérieur ou égal à 2.000.000 €, la contribution sera d’un montant fixe de 100 000 €).
Les demandeurs ne remplissant pas ces seuils ne sont pas assujettis à la CJE.
D’un point de vue pratique, afin de justifier de sa situation au regard des seuils ci-dessus, la circulaire du 6 février 2025 indique que le demandeur devra transmettre les comptes de résultats des trois derniers exercices ainsi que les formulaires 2052 et 2053 – compte de résultat de l’exercice de la liasse fiscale du régime réel normal.
La nature des demandes assujetties au règlement de la contribution
Selon l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023, la contribution est due pour chaque instance introduite devant un TAE à l’exception de certains litiges relatifs à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au Livre VI du Code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Mais une difficulté peut se présenter si le demandeur à l’action ne forme pas de demande pécuniaire, mais sollicite par exemple, à titre principal, qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit pour évaluer son préjudice ; la nullité d’un contrat (sans prétentions indemnitaires) ; ou encore l’exécution forcée d’une obligation de faire ou de ne pas faire. A défaut de prétention pécuniaire, de telles demandes ne devraient pas être assujetties au règlement de la CJE, mais les textes et la circulaire sont muets sur ce point.
De même, une difficulté pourrait surgir lorsque le demandeur forme ses demandes pécuniaires initialement dans le cadre d’une instance en référé-provision avant de les porter devant le juge du fond. Dans une telle hypothèse, une dichotomie pourrait exister selon que l’affaire est portée devant le juge du fond via la passerelle prévue à l’article 873-1 du Code de procédure civile ou au moyen d’une assignation distincte (notamment en cas de rejet de la demande en référé). Dans le premier de cas de figure, la logique voudrait que la CJE ne soit payée qu’une fois par le demandeur, l’affaire étant portée au fond par décision du juge des référés. A l’inverse, dans le second, le demandeur pourrait se retrouver contraint d’avoir à acquitter une nouvelle fois la CJE (les instances en référé et au fond étant distinctes). Les textes et la circulaire sont cependant muets sur ce point.
Certaines demandes sont en revanche expressément exclues du champ de la CJE.
Tel est notamment le cas de certaines demandes considérées comme n’étant pas des “demandes initiales” (tierce opposition, rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer, demande d’interprétation, rétractation d’ordonnance sur requête)3.
Les demandes incidentes, c’est-à-dire les demandes reconventionnelles, additionnelles ou d’intervention, ne sont pas non plus soumises à la CJE (art. 63, CPC)4:
- L’exclusion des demandes reconventionnelles est a priori logique, car elles émanent du défendeur à l’instance, et non du demandeur initial, sur qui pèsera le coût de la contribution (art. 64, CPC).
- L’exclusion des demandes additionnelles (qui permettent à une partie de modifier ses prétentions antérieures) est également compréhensible en son principe puisque le montant de la contribution doit être évalué sur la base de l’acte introductif d’instance (art. 65, CPC). Toutefois, il n’est pas précisé comment sera traité le cas où une demande initiale, chiffrée “à parfaire”, est revue à la hausse ou à la baisse en cours de procédure.
- Quant à l’exclusion des demandes d’intervention (volontaire ou forcée), elle est également logique en ce qu’elles n’ont pour effet que de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, et pour lequel le TAE aura déjà examiné l’exigibilité de la contribution par le demandeur initial (art. 66, CPC). Ainsi, une partie formant un appel en garantie à l’encontre d’un tiers en procédant par voie d’assignation en intervention forcée ne devrait pas être tenue au règlement de la CJE (quand bien même le montant dont la garantie est sollicitée serait chiffré et supérieur à 50.000 €).
Assureur, coassureur, assuré : qui doit supporter la charge de la CJE en tant que dépens ?
La CJE est instaurée par l’article 27 de la loi n° 2023-1059 “par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts“. Selon ces dispositions auxquelles il est fait exception, “les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire” (art. 1089 A, CGI) et “les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives” (art. 1089 B, CGI) ne sont pas soumis au droit d’enregistrement “ni à toute autre taxe prévue par le CGI” concernant les actes de greffe.
Comprise dans les dépens, qui incluent “les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts“5, la CJE est en principe mise à la charge de la partie perdante “à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie“6. Cette décision relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond7.
La prise en charge de la CJE soulève des difficultés d’ordre essentiellement pratique dans les relations entre assureur et assuré, mais également en cas de coassurance.
Allocation dans les relations assureur-assuré lorsque l’assuré est en défense
En matière d’assurance de responsabilité civile, certains auteurs soutiennent que, depuis la suppression de la présomption de prise en charge des dépens par l’assureur responsabilité civile qui figurait à l’ancien article R. 142-2 du Code des assurances, la prise en charge par l’assureur de dépens auxquels serait condamné l’assuré exige une stipulation expresse dans les polices.
En effet, une condamnation aux dépens ne constitue pas à strictement parler une dette de responsabilité dans la mesure où les dépens peuvent ne pas être mis à la charge du responsable (art. 696, CPC).
A défaut de clause relative aux dépens, la prise en charge de la CJE par l’assureur de responsabilité pourrait donc donner lieu à débat et la vigilance sur la rédaction des garanties devrait être renforcée.
Cependant, lorsque l’assureur est partie à l’instance et personnellement condamné aux dépens seul ou in solidum avec son assuré, il pourra difficilement échapper à leur prise en charge.
De même, lorsqu’il a pris la direction du procès, l’assureur pourra difficilement refuser la prise en charge même en l’absence de stipulation expresse dans la police.
Allocation dans les relations assureur-assuré lorsque l’assuré est en demande
Il peut arriver que l’assureur prenne en charge les frais du recours de l’assuré contre les tiers.
Ce sera le cas de l’assureur de protection juridique ou encore de l’assureur de responsabilité civile ayant stipulé une clause de “défense-recours”.
Les frais pris en charge incluent généralement les dépens à avancer par le demandeur (frais d’huissier, de traduction, …) et pourraient donc également inclure la CJE, sous réserve des termes exacts du contrat concerné.
Ce sera encore le cas de l’assureur de responsabilité civile ou de choses qui a indemnisé son assuré et entend recouvrer l’indemnité payée auprès du tiers responsable. Lorsque l’assuré conserve un découvert et/ou une franchise, assuré et assureur peuvent envisager un recours commun et s’entendre sur le fait que les frais de défense seront pris en charge par l’assureur seul. Se pose alors la question de la prise en charge de la CJE.
En cas de pluralité de demandeurs, “la contribution pour la justice économique est due par chacun d’eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun“8. Comme le précise la circulaire, chacun des demandeurs initiaux dont les prétentions dépassent les seuils sera tenu au versement de la contribution, calculée selon le montant de ses prétentions.
Dans le cadre d’une assignation commune, il faut donc déterminer séparément l’assujettissement et le montant de la CJE dont devront éventuellement s’acquitter l’assureur et l’assuré, chacun en fonction du seuil qui lui est applicable. La CJE incombant à l’assuré devrait donc rester à sa charge, sauf accord contraire des parties pour que l’assureur la lui rembourse.
Allocation entre coassureurs
En matière de coassurance, deux situations doivent être distinguées :
- chaque coassureur est demandeur à l’action : comme évoqué ci-dessus, les seuils et le montant de la CJE s’apprécient séparément pour chaque demandeur9 ; chacun des coassureurs sera donc redevable de la contribution, à concurrence du montant de sa demande, qui sera proportionnelle à sa part dans la coassurance. Chaque coassureur devra fournir les renseignements le concernant au greffe.
- seul l’apériteur figure comme demandeur à l’action au nom de la coassurance, ayant un mandat de représentation en justice de l’ensemble des coassureurs : seul l’apériteur devra s’acquitter de la contribution. La CJE étant considérée comme un dépens, elle devrait en principe relever des dispositions convenues entre coassureurs sur la répartition entre eux des frais du recours. Les clauses de coassurance pourraient néanmoins à l’avenir préciser l’obligation pour les coassureurs de rembourser l’apériteur des fonds dont il a fait l’avance au titre de la CJE dans leur intérêt.
La CJE : un nouveau facteur de choix entre différents tribunaux ?
Le coût de la CJE pourrait être désormais un paramètre pris en compte dans le choix du Tribunal que l’on saisit.
Choix lors de la saisine du tribunal
L’introduction des TAE et de la CJE pourrait donner lieu à une nouvelle forme de forum shopping. Ainsi, lorsqu’un choix entre plusieurs tribunaux territorialement compétents leur sera offert entre un TAE et un Tribunal de commerce, les demandeurs pourraient préférer saisir le second pour ne pas avoir à régler la CJE.
Il conviendra toutefois de bien s’assurer de la compétence territoriale et matérielle du tribunal saisi afin d’éviter des déconvenues liées au paiement de la CJE.
En effet, si une affaire est renvoyée vers un TAE par une autre juridiction en vertu d’une décision d’incompétence (matérielle ou territoriale), alors le demandeur devra s’acquitter de la CJE. En revanche, en cas de décision d’incompétence d’un TAE au profit d’un autre TAE, la CJE ne sera due qu’une seule fois.
Inversement, lorsqu’un TAE est saisi et que celui-ci se déclare incompétent au profit d’un autre type de tribunal, alors le demandeur ne pourra en principe obtenir le remboursement de la contribution qui sera normalement mise à sa charge au titre des dépens par la décision du TAE se déclarant incompétent.
Il est à noter que les assureurs organisés sous forme de mutuelles ne relèvent pas de la compétence des juridictions consulaires (art. L. 322-26-1, C. ass). Les contentieux opposant les bénéficiaires (assurés, tiers lésés) aux mutuelles devraient donc continuer à être portés devant les Tribunaux judiciaires devant lesquels la CJE n’est pas due.
Choix lors de la rédaction des clauses attributives de juridiction
L’expérimentation des TAE pourrait d’ores et déjà avoir un impact sur la rédaction des clauses liées à la compétence juridictionnelle dans les contrats commerciaux.
Lors de la rédaction de leurs contrats ou conditions générales, des sociétés relevant du ressort territorial d’un TAE pourraient préférer insérer une clause attributive désignant un tribunal de commerce d’un autre ressort lorsque cela leur est permis pour limiter leurs frais de justice. Inversement, prévoir une clause au profit d’un TAE va rendre un recours à leur encontre plus coûteux, et pourrait ainsi dissuader d’éventuels plaideurs.
Choix en faveur des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ?
Le paiement de la CJE pourrait également favoriser l’inclusion de clauses d’arbitrage dans les contrats, car les frais d’une procédure arbitrale pourront, dans certains cas, être inférieurs au montant de la CJE, en particulier dans le cadre de procédure d’arbitrage accélérée et/ou avec un arbitre unique10.
Un remboursement de la CJE est prévu en cas d’accord amiable en cours de procédure (en cas de désistement ou à la suite d’une transaction consécutive à une médiation ou une conciliation). Il s’agit là de toute évidence d’une nouvelle incitation faite aux parties de recourir davantage aux modes amiables de règlement des différends.
Note de bas de page
- Article 26, Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ; Article 1, Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
- Article 1, Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
- Article 1, II, Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
- Article 1, I, Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
- Article 695, 1° du Code de procédure civile.
- Article 696 du Code de procédure civile.
- Cass. com., 15 février 2005, no 01-17.523.
- Article 1, Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
- Article 1, Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
- Voir par exemple le barème d’Arias France pour les arbitrages en matière d’assurance : https://www.arias-france.fr/arbitrage/bareme-darbitrage/.